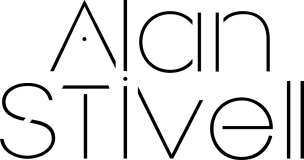apprendre le breton
Comme dans tout dans la vie, il faut trouver le juste milieu. Ce phénomène existe en français, qui a adopté l’anglais « support » dans le sens de « soutenir, supporter », on « supporte » donc une équipe (remarque dans mon cas concernant le foot, je supporte, mais dans le sens d’endurer ! remarque tout à fait personnelle). J’ai remarqué également qu’on emploie de plus en plus en français le mot « définitivement » dans le sens de l’anglais « definitely » ; or celui-ci veut dire « absolument, tout-à-fait, résolument.
Même chose avec « visiter », on disait il n’y a pas si longtemps « rendre visite ». Comme quoi les langues s’influencent les unes les autres ; il ne faut pas en arriver au point de plaquer des mots bretons sur des structures françaises ; le contraire n’est pas grave. L’anglais a fait cela avec le français au Moyen-âge et à la Renaissance, d’où le nombre incalculable de mots d’origine française en anglais, pourtant l’anglais est resté de l’anglais, avec ses expressions et ses structures.
N’étant pas linguiste, ni près de l’être, je n’ai aucune envie de faire de la grammaire mon sujet principal. C’est ce qui me fait constater qu’aujourd’hui on confond trop facilement grammaire et phénomène de cvilisation et toute conversion
de la civlisatin française dans la civilisasition bretonne est une perte plus ou moins grande pour les deux pays.
Savez vous, par exemple, que la femme celte du prmeir siècle avaiit plus de drois que la femme française d’aujourd’hui?
En ce qui concerne l’invasion des mots français dans le breton, c’est un sujet de moquerie pour les uns et de honte pour les autres. Que de fois n’entend t-on pas des apprenants reprocher aux anciens ce qu’on appelle « Gallekadur ar brezoneg ». Or cette francisation du breton se retrouve partout. Dans le vocabulaire des anciens mais aussi et de façon horrible dans la structure des phrases des apprenants. Il faut donc, à mon sens se battre bec et ongles contre ces deux défauts majeurs qui représentent, à mon sens, les pires ennemis de langue sur le plan de son apprentissage…
C’est la position que je prends. Je ne demande à personne de partager mon avis…… Je sais cependant que si je parlais avec un certains vocabulaire (notamment avec certains néologismes) à mes voisins, ceux-ci me tourentaient vite et j’attraperai un surnom pas très élogieux sortant directementdu pressoir…
A titre d’exemple, voici une phrase écrite par un des grands « écrivains contemporains » qui utilisent du « Demat » à longueur de jour. Pouvez vous me dire combien d’erreurs il y a dans cette simple phrase?
AER AR MOR, C’HWEZ AR BEZHIN ENNAN…….
Le mot « Merci » ( j’y reviendrai) n’a pas d’équivalent très net en breton pour la simple raison que la société vivait sous
la loi du remboursement du service rendu qui équivalait à un « merci matériel ». (Voir P.J Hélias sur ce chapître) .Le mot AOTROU ne s’appliquait qu’à certaines personnes car la société bretonne était plus égalitaire que la française. Toutes les telltres que je reçois de gens ayant appris le breton commencent par » Aotrou Ker ». Toutes les lettes que je reçois de vieux bretonnants natifs commencent par: « D’am hamalad Untel…. » (Voir également PJ Hélias sur ce dhapître dans « Le panatalon à sarcler ou » l’horloge sur pieds »…. Le code de politesse breton est ‘d’un raffinement dont les apprenants n’ont
pas encore pris connaissance….. Si d’emblée, dans leur apprentissage on les met , les yeux fermés sur la voie Brest Paris, alors, à mon avis, ce n’est pas la peine de prendre le train. On apprend le breton pour devenir breton. On n »apprend pas l’anglais pour devenir britannique. Le breton est la langue que nous portons en nous….
Bonjour,
Tiligne, qu’entendez-vous par l' »authentique » ?
Une langue vivante doit rester ouverte à l’intégration de mots nouveaux. Il est nécessaire qu’une langue évolue sans cela elle signe sa fin.
Le Japon me semble la dessus beaucoup moins rigide, il se place dans un mouvement perpétuel. Le terme « tradition » en japonais contient en lui même cette idée de mouvement, de changement.
Bien sûr une norme est utile pour la communication, l’apprentissage et pour cadrer les spécificités de telle ou telle langue. Mais globalement, on ne trouve pas trois grammaires identiques.
Le risque, c’est effectivement le sort actuel de la langue anglaise érigée comme langue de communication. Une langue que l’on impose maintenant dès le primaire (déjà que j’ai eu du mal avec le français…)et qui est souvent perçu comme une contrainte.
Honnêtement je ne suis pas suffisamment au fait pour constater l’effet néfaste que cela a engendré, mais j’ai le sentiment qu’en devenant « langue universelle de communication » l’anglais tend à s’appauvrir. D’ailleurs, on qualifie plus cette langue de Globish.
Chaque langue doit être une ouverture, une rencontre avec une culture. C’est aussi l’utilisation de Signes nouveaux qui peuvent influer sur nos perceptions. Il est sans doute mieux que l’apprentissage d’une nouvelle langue parte d’une démarche, d’une volonté personnelle.
A ce titre, l’émission d’hier « sur les épaules de Darwin » sur France Inter parlait de l’apprentissage de la lecture, de la langue maternelle ou de l’enrichissement qu’offrait chaque langue. Je n’ai pas pu tout écouter mais le site propose des liens de lecture qui peuvent être intéressants
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/sur-les-epaules-de-darwin/
Bref, mon « raisonnement » reste sans doute peu solide.
Juste qu’une langue artificielle de communication comme l’espéranto me paraît être une très bonne chose. C’est une façon de ne pas ériger UNE langue comme « dominatrice ». Puis son système est plus simple et permettrait à des personnes qui n’ont pas forcement le temps, les moyens ou même le talent d’apprendre des langues de pouvoir communiquer avec le reste du monde. C’est pourquoi ça ne me paraîtrait pas idiot qu’on enseigne l’espéranto à l’école plutôt que le globish.
Et pour finir, doit-on forcement parler breton pour devenir Breton ?
Xavier Grall, bien que ne maîtrisant pas le breton, se sentait je crois profondément Breton (mais là encore, je ne connais pas suffisamment le personnage).
Voilà ce que je peux dire !
Bonne soirée !
alice
Ce que j’appelle langue authentique c’est cette langue naturelle parlée par les anciens. Or celle-di, sous diverses influences, souvent pas très heureuses, a subit des dégâts assez importants. Le principal ennemi de la langue bretonne est la translittération par rapport au français. Ce danger a fait beaucoup de ses défenseurs des critiques intransigeants, souvent excessifs……Il le faut car le risque est bien réel….
Essayer de lutter contre la « francisation du breton » dans sa structure est une chose qui doit motiver tous ceux qui veulent transmettre la langue…
Dans le autres pays la langue ne court pas les mêmes risques même si les vocabulaires ont influencés. La trame de la langue retse lla même…….
Alice nous dit:
» Et pour finir, doit-on forcement parler breton pour devenir Breton ?
Xavier Grall, bien que ne maîtrisant pas le breton, se sentait je crois profondément Breton (mais là encore, je ne connais pas suffisamment le personnage). »
Je ne voudrais pas passer pour « un par dube ». En breton, un par dube est un pigeon mâle dont le roucoulement ressembla à: « Me ‘ oar ober toud! me ‘ oar ober toud » (Je sais tout faire! je sais tout faire! » . Donc « Monsieur je sais tout…..
J’ai proposé de lire des livres concernant les celtes écrits par des non bretons pour accompagner l’apprentissage de la langue.
Il est bien clair que ceci montre bien qu’à mon avis ‘il n’est pas besoin de parler breton pour se sentir breton.
Je ne suis pas un « sergent recruteur » mais un défenseur de la langue. Apprend le breton qui veut. Mais quant à l’apprendre il vaut mieux bien l’apprendre. Les plus beaux exemples que j’ai pu voir avec des apprenants est le changement d’attitude des natifs à leur égard. Quand les néo-bretonnants ne s’entendent lus dire, en français « Ce n’est pas le même breton » mais, au contraire « Rêzon ‘ peus. Va zad ha va zad koz a gomze e-mod-se » (Tu as raison. Mon père et mon grand-père parlaient ainsi.)
Mais il n’est point besoin de parler breton pour devnir breton. Il existe au fond de chaque être des principes innés de culture populaire qui doivent nous permettre de savoir d’où on est. La culture bretonne, i elle était basée uniquement sur la langue serait en bien triste état. Heureusement que nous avons plusieurs cordes à faire vibrer sur notre harpe…
Il m’est difficile de répondre à propos de X.Grall. Je n’ai lu de lui que « Le cheval couché » réponse au cheval d’orgueil qui ne posait aucune question. Grall, de son propre aveu, n’avait pas lu Hélias quand il a fait son livre qui, après « enquête » d’est avéré être un arragement ente éditeurs…. Il se trouve que j’ai tout lu d’Hélias (sauf deux romans en français). Hélias n’est jamais lu d’assez près. Ses écrits non violents mais répétés, redits, font réellement œuvre de militant. Par pour ceux qui veulent aller vite…. Et puis, il y a une chose que je trouve désagréable: Des gens comme Grall qui avec beaucoup de flamme parlent d’une Bretagne qui leur est linguistiquement inconnue me semblent se servir de ce militantisme comme d’un alibi d’avoir la « flemme » de se mettre au breton. Il y a une contradiction flagrante en langue bretonne: « Ce sont ceux qui la défendent le plus qui en sont souvent les plus piètres locuteurs et ceux qui la connaissent le mieux qui la défendent le moins
En termes clairs on peut être un chaud défenseur de la culture bretonne sans bien connaître la langue et un médiocre défenseur de sa langue tout en la connaissant à fond….. On va me dire que j’exagère… Allons vidons notre sac:
Parmi les écrivains natifs, tous, ou à peu près aujourd’hui disparus, combien y en a-t-il qui ont apportés leurs lumières ?
« Yeun ar Gov, V.Seité – Trepos – V.Trepos – Drezenn, F.Morvannou et quelques autres… » et parmi les écrivains néo-bretonnants ne peut-on pas voir des livres entiers pensés en français….. Allons jusqu’au bout, puisque la question a été posée. Suite à la thèse de Ronan Calvez sur la comparaison entre les radios de P.J Hélias et de R.Hemon, la question a été débattue et il a été clairement dit que le roman « Nenn Jani » dernier livre d’Hemon et qui aurait dû être son chant du cygne était entièrement pensé en français….
Oui, la mondialisation oblige tous les pays à un vocabulaire international. Mais certainement pas au point de voir une langue
se réduire aux règles de grammaire d’une autre avec un vocabulaire différent dans lequel on trouve souvent des néologismes bidons….
Je vais en citer un: Un cours de breton ( Per Denez: Kenteliou Brezhoneg) donne « tOmmerez Kreiz » pour chauffage central.
Quand j’ai fait connaître cette définition au voisinage il y a eu un clat de rire général : »Tommerez kreiz? Penaoz e vo tommet
ar hozteziou neuze? » (Chauffage de centre? Comment alors va-t-on chauffer les côtés? »
Question: Comment diriez vous chauffage central en breton? »
Bonne journée à tous!
justement, puisque vous trouvez drôle « Tommerez kreiz », que proposez vous? Puisqu’il faut bien proposer plutôt que rire. Même si ça fait du bien de rire.
Se sentir Breton: j’ai évoqué qqpart les différents sens de « Breton » en français, puisque le breton en propose au moins 2.
Il n’y avait aucune moquerie dans le rire provoqué par an « Dommerez kreiz……
Pour les autres mécaniques, à voiles ou à essence; le peuple a trouvé des néologismes naturels du type:
Karr dre dan – bag dre lienn et tour récemment pour planche à voile on entend: Plankenn dre lienn qui est un néologisme excat
La préposition « Dre » indique le moyen et les mots composant la machine doivent illuster fidèlement sa fonction:
J’avais, il y a longtemps proposé: chauffage central : Tommerez de zour bero……
Le mot a été retenu car il figure dans le « Geriadur de A.Le Mercier page 692.
Je l’ai fait passer dans des conversations « populaires ». Personne n’a levé les bras au ciel…
Au demeurant le « Tommerez kreiz » est aussi une copie au mot à mot à de l’ anglais: Centrak heating.
Ce serait une erreur de croire que l’anglais pourrait nous donner la clé des néologismes.
La langue bretonne est assez forte pour fabriquer les siens elle-même. Dans les cas d’exception il faudrait avoir recours au vocabulaire international compris de tous……
Cet exemple de la non utilisation de la préposition « Dre » monter que les prépositions qui sont à la base de la compréhension de la langue bretonne ne sont pas étudiées d’assez près dans les méthodes d’apprentissage….
On pourrait faire une remarque en passant. Un peu d’étude du breton nous montre que l’œil a la primeur sur la langue qui décrit avec exactitude ce qui a été vu. Il y a moins d’abus de langage en breton qu’en français….
Dans une pièce de Maria Prat j’avais trouvé cette phrase: Eet eo e gig a-ziwar e eskern. qui traduit fidèlement la phrase en français; « Il ne lui reste plus que la peau et les os. » phrase maintes fois traduite mais avec moins de précision que celle de Maria Prat….C’est un exemple qui me semble bon à suivre….
Deux autres exemples pris sur le vif:
N’ema ket mui he spered ganti: Elle a perdu la tête.
et
Kollet he-deus he fenn : elle a la maladie d’Azheimer (Ort????)
Il faut toujours avoir en tête la précision quasi diabolique du breton..
chacun apporte sa pierre.
Il est bon que vous confirmiez que « plankenn dre lien » est exact. Par contre il est bon que votre avis soit complété. Traduire, c’est bien, mais pas si le mot n’a aucune chance d’être utilsé; ceci pour une raison simple: beaucoup trop long, et pas assez coulant, en particulier pour un surfiste…
Je trouve qu’abréger n’est pas anti-breton. On peut se passer de « dre » et même plus. « Karr-dre-dan », peut, à mon avis, se dire « karr-tan »; mais c’est encore trop, puisque … »karr » est suffisant. En effet, jadis, pas besoin de préciser que c’était à cheval, aujourd’hui pas besoin de préciser que c’est à moteur, il faut au contraire préciser quand c’est à cheval (« karr-jav »?).
Pour revenir au wind-surf, je préfere « astell-lien », je sais que « astell » n’est pas exactement « planche », mais s’en rapproche, et aurait plus de chance de succès pour la facilité et l’harmonie.
Pour ce qui est de corriger les néo-bretonnants, c’est très bien, évidemment.
Mais ne pas oublier que, si nous ne parlons pas breton aussi bien que français, c’est quand même un peu la faute des bretonnants de naissance, qui n’ont eu aucun effort à faire (sur ce plan) et qui auraient pu et pourraient faire l’effort, justement, de nous répondre. Pour nous comprendre, même les plus débutants, il suffirait qu’ils tendent l’oreille, et qu’ils apprennent à lire un minimum. La plupart sont maintenant en retraite. Un bretonnant de naissance, forcément bilingue aujourd’hui, peut, s’il veut, comprendre n’importe quel débutant qui mélange deux langues familières.
Je vois bien que vous n’êtes pas contre toute évolution. Il faut quand même penser aussi qu’on ne va pas demander à un cultivateur de …s’atteler à la création de vocabulaire, concernant le Droit international, l’astrophysique, la philo, etc. Rien de péjoratif dans ce propos, une spécialité est une spécialité. Je suis d’accord pour ne pas être d’accord sur nombre de choix « néologistiques ». Sachant qu’on peut souvent admettre deux sinonymes.
Pour être efficace, on peut se battre sur quelques points concrets.
Comme je l’ai dit ailleurs, je milite contre la version actuellement généralisée du chant « Joyeux anniversaire ». Il contredit affreusement l’accentuation bretonne, et, en plus, fait passer les bretonnants pour des éléphants du swing! Je m’attache au maximum de respecter les accents toniques quand j’écris une chanson. Et je dois signaler au passage que la chant traditionnel, et donc rural, les respecte souvent mal! Ce ne sont pas toujours les même qu’il faut corriger. Je crois qu’on trouve ce type d’erreurs dans des chants interprétés par la grande et regrettée Eliane Pronost.
pour compléter, je dois dire qu’à mon avis, votre choix de « Tomerez dre zour bero » ne convient pas. Tout bretonnant s’en tiendrait au mot français, même en retraite. L’âme française (ou anglaise) serait plus concise que l’âme bretonne?
Je pense qu’un néologiste aurait pu faire pire que « Tomerez-kreiz », la tendance aurait été d’inventer « tomerez kreizel » ! Et pourquoi les francophones ne se demandent pas si le chauffage central chauffe les côtés??? 
Il n’est pas impossible que « Tommerez dre zour bero » ne convienne pas. Cependant, quand je vois les noms des collaborateurs du dictionnaire Garnier , je reste sur mon idée qui, au demeurant expérimentée autour de moi, et bien que mes voisins disent « OTO » au lieu de Karr dre dan » , a connu son petit succès……
J’ai oublié de donner les erreurs de la phrase: Er ar mor, c’hwez ar bezin ennañ…..
Ière faute: er ar mor est un gallicisme – l’air n’appartient pas à la mer – on dit: an er vor : l’air marin.
2 éme faute: elles est double: c’hwez ar bezin ganti ( pas ennañ – féminin préférable pour er qui fait muter mor…
De la même manière et pour les mémes raisons on ne dira pas: overenn ar mintin mais on overenn vintin
Ce point est discutable…..
Voici deux jolis « tro lavar » entendus dernièrement: Pep hini a ree Pil – Sonn anezañ med F. An Uhel a oa e ano gwirion war a bedenn zul
Il était surnommé Pil-Sonn ( car il était droit comme un I) mais il était cité comme F.An Uhel lors de la liste des offrandes de messe à l’église…..
Ar bedenn zul (et non Pedenn ar zul): la longue liste de ceux qui ont offerts des messes aux défunts. Il arrivait souvent aux gens de ne pas savoir qui était le donneur tant son nom véritable était caché par son surnom….
Bien sûr, il est clair que le mot « Chauffage central » e st le mot utilisé par les natifs dans la conversation courante.
Bref……
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Trugarez est aussi un autre mot délicat. Couramment utilisé comme merci , puis transformé en « Trug » il avait, il n’y a pas si longtemps, un sens très différent.
Le « remerciement breton » , si on en croit les anciens, n’existait que sous la forme du service rendu en dédommagement d’un autre service rendu. .J Hélias en parle longuement dans le cheval d’orgueil. Les civilités du français ayant quelque peu déteints sur le breton, on a utilisé « Mersi » puis « mersi braz » pour un remerciement plus fort…… Puis, peut-être pour rendre ce « mersi » qui fleurait de trop près la langue de Voltaire, on lui a substitué « Trugarez » que je n’entends jamais dans la bouche d’un bretonnant natif……
Visant Seité, dans les cours qu’il faisait dans le « Télégramme » (Un peu avant 1980) nous donne une application de ce mot. La voici:
Ya, evel beziou an eskibien e Iliz-Veur Kastell-Paol. Kizellet er vein galed, ema warnañ, astennet war greiz e gein, juntet gantañ e zaouarn. Daou êl bihan a zoug e benn a-zioh eur plueg. E dreid a zo stok ouz eul leon a weler o krignad eun askorn. En e gichenn ez eus eur pez kleze noaz gand eun all berroh, hag unan bihannoh c’hoaz ouz e gostez, anvet “trugarez” hag a zerviche d’ar marheg da beurlaza e enebour gloazet. Stag eo hemañ ouz eur gouriz a lenner warnañ geriou stur marheien Kerouzere: “ List! List!”
Dans ce texte écrit par un écrivain incontestable (surtout sur le plan religieux!), le mot « Trugarez » est utilisé comme « épée courte » servant à donner le coup de grâce au chevalier vaincu quand celui-ci est à la MERCI
de son adversaire…… C’est également la définition que donne le
« Garnier » (Page 438) ou la traduction de « merci » n’ apparaît pas…..
Entendons nous bien, je n’ai rien contre le Trugarez employé comme « merci ». Déjà le fameux « Bennoz Doué » est très fort……
Pour ma part personnelle et dans la vie courante, je m’en tiens au « mersi » ou au « mersi braz » comme tout un chacun autour de moi, y compris dans ma propre maison…
L’n des mots français que je trouve le mieux adapté au breton par les anciens est le mot « Kodak » (est-il français???) marque d’appareil photo que les premiers touristes portaient tous en bandoulière.
Eur hodaker: un touriste – ar godakerien: les touristes…..
Il me semble que vous en restez au Breton rural, et que vous ne tenez pas compte: de mes observations sur les formes de politesse généralement d’origine aristocratique, que Merci vient aussi de Pitié, et que l’évolution la meilleure ne serait pas un copié-collé du Breton rural traditionnel, ni une francisation, mais un choix judicieux, bien pensé, de néologismes (quand nécessaire), tenant compte de la longue histoire de la Bretagne et sa langue, des impératifs de la vie moderne, de la comparaison avec les autres langues, notamment les celtiques et les voisines.
TRUG ! (j’ai imaginé cette abréviation à la maison avant que des jeunes bretonnants autres que mes enfants l’imaginent eux aussi).
J’ignorais que ce diminutif de « Trug » avait A.Stivell comme origine… çà ressemble un peu à « O.K » ou à « D’acc » pour d’accord.
Après tout pourquoi pas.
Bien sûr que je me tiens au breton rural. C’est celui que j’entends autour de moi….. Et puis, il y a tellement d’erreurs faites par ailleurs que trouver, de temps à autre, une expression valable doit bien servir à quelque chose….
Il vaut mieux, je crois, s’entende dire « Rêzon ‘ peus, va zad ha va zad koz a gomze e-mod-se’ que de s’entendre répondre comme cela, hélas, arrive trop souvent « Ce n’est pas le même breton. »…. Savoir que « Trugarez » est aussi une épée qui sert à donner le coup de grâce me semble profitable….
Je pense que nous avons dû être plusieurs à inventer « Trug » en même temps. C’est une évolution assez automatique, effectivement du même style que « OK » ou « Dac ».
Dans les années 70, mon régisseur Claude Jarroir m’avait entendu dire « Trug » dans une tournée bretonne. Il avait été enthousiasmé par l’idée que le Breton pouvait être si actualisé.
Si vous suivez mon travail, vous savez que, déjà en musique, j’attache une énorme importance à de vraies bases traditionnelles, donc l’héritage rural, pour que la modernisation ne soit pas du « n’importe quoi ».
L’histoire de la Bretagne aurait été toute autre, nous n’aurions pas eu le besoin impératif de se ressourcer de la sorte. Chez d’autres peuples plus chanceux, l’individu artiste-créateur peut s’exprimer, des manières les plus contemporaines, et sans commencer par une phase formation traditionnelle, mais il n’est pas déraciné. C’est le cas de n’importe quel artiste américain, voire français. Mais les rapports de force avec notre puissant voisin ne l’a pas voulu ainsi. Donc nécessité de s’imprégner profondément de ce qui reste de la tradition.
Mais ensuite, comme vous savez, la modernisation, telle que je l’entends, doit être audacieuse, liée à la vie urbaine, TGV et influences tous azimuts.
Ce qui est vrai en musique, est vrai pour la langue, comme pour tout.
De vraies bases pour que les différences, qui sont l’essence même des peuples, intemporelle et pas liée simplement à une corporation ou une classe sociale, soient pérennisées. Assez fortes pour ne pas être détruites par les apports extérieurs, ceux-ci au contraire bien digérés, comme les cultures et civilisations le font depuis l’origine de l’humain.
Le fait qu’il y ait eu une génération spontanée de trug qui, par la suite se soit généralisée est, effectivement, quelque chose d’intéressant….
Il me semble avoir compris qu’il fallait déplacer le chapitre de « Deiz ha bloaz » relatif à l’anniversaire de la mort de quelqu’un sur le fil « Apprendre le breton »…..
Voici quelques expressions populaires concernant ce triste sujet:
Marvet eo gand ar maro brao en e wele: Il est mort de sa belle mort – Il est mort de mort naturelle à la maison.
La mort subite: Ar maro soubit – ar maro trumm.
Un peu plus gai sous la plume de Y.Biger ( de mémoire): Sammet e oa bet gand an Ankou hep kleved trouz e gammedou na zoken fraoñv e falc’h. Il y a un comique irrésistible dans cette phrase….
Un mot qui s’est hélas perdu: butugenn
Lonket e-neus e vutugenn qui peut se traduie par: Il a avalé sa chique – son bulletin de naissance – cassé sa pipe….
Il semblerait que « butugenn » se rapprocherait de « de bouffée de cigarette »…..
Bien des expressions sont très difficiles à situer comme (rien à voir avel la mort):
Hennez e-neus eur genou kazah…..
Cela veut-il dire: Il parle comme une mitraillette – vite – il lance des postillons….
Si quelqu’un avait des lumières là-dessus…..
Plus classique: O tresa e dalarou ema: il creuse son denier silon war e dalarou ema.
La plus saisissante des expressions de ce type nous donne une vision saisissante de la mort et de la condition sociale et
doit être de grande valeur pour les historiens:
Un paysan sur le point de mourir: Me a zo dizouarnet evid mad: Je suis déferré pour de bon.
Entendu par PJ Hélias et cité dans « Marh al lorh » qui nous montre la pauvreté dans laquelle on avait réduit la Bretgagne ce qui obligeait les paysans à récupérer les fers des chevaux mourants pour les mettre sur d’autres…. Voilà, à mon sens, une belle acquisition de langue et de civilisation…..
Une « faute populaire ». On voit sur les monuments aux morts: « Maro evid ar vro » et, parfois « Marvet evid ar vro »…
Laquelle des deux est la bonne? Je prends la seconde……
Liou ar maro a zo war e gig: Il est pâle comme un mort.
Tres ar maro a zo warnañ: Il est très mal en point.
Eun interamant seh: Personne ne pleure – le mort n’est pas regretté (Même chose pour eun ti seh: Jamais d’apéro n’est offert au
visiteur)
Pondalez an ene: L’endroit de la bouche d’où s’échappe le dernier soupir…..
Va bouzellou am-eus karget beteg pondalez va ene: Je m’en suis mis plein les trous de nez…..
Me a zo karget beteg ar skoulm… (même sens) –
Sens quelque peu atténué: Me a zo ront va jiletenn….
ken ar henta….