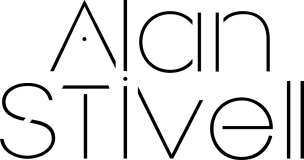RAPPELER QUELQUES FAITS
Des nouveaux livres viennent de sortir concernant l’Histoire générale ou contemporaine bretonne.
Le « Dictionnaire d’Histoire de Bretagne » de Skol Vreizh et « L’étonnante scène musicale bretonne ».
Je n’ai pas encore lu ces livres. En ce qui concerne le second, les présentations me paraissent douteuses.
En effet, une fois de plus, notre volonté, à Glenmor et à moi-même, de promouvoir une scène professionnelle bretonne, semble « remixée » dans l’éternelle « boîte à surprises » des chanteurs et musiciens bretons.
J’engage les visiteurs de mon blog à parcourir ces écrits et donner leur avis ici (ou aux éditeurs concernés).
La vérité est toujours bonne à dire.
Grace à Mireille Morel et Yann-Bêr (Harpographie), j’ai pu lire un passage du deuxième livre (car je n’ai pas encore eu le loisir de l’acheter).
Et je dois dire que je n’ai pas à me plaindre des propos élogieux (un peu trop?) à mon égard.
Et, sans avoir lu le reste du livre, il semble que la chronologie est respectée; ce qui tranche avec bien d’autres écrits. Car, en effet, ce n’est pas avoir un égo démesuré (même si l’anecdote de ma musique dans l’espace… -un rêve de Paddy Moloney également-) d’apprécier que l’histoire des années 66-76 soit racontée aux plus jeunes, telle qu’elle s’est déroulée et non distordue.
Une fois de plus, grâce à Yann-Bêr, j’ai pu prendre connaissance des éléments concernant le mouvement musical en Bretagne.
J’ai pu constater comment des auteurs « sérieux » baclent leur travail, ne prenant ni le temps de chercher les faits exacts, ni celui de présenter les choses de manière claire et non-ambigue au béotiens que sont la plupart des lecteurs.
Je parle évidemment de faits indiscutables, étayés, que j’ai vêcu, comme de ceux que j’ai pu démontrer notamment avec Jean-Noël Verdier dans notre livre sur la harpe bretonne.
Mais je laisse volontairement planner le doute sur l’ensemble du livre. Car pourquoi cette façon de faire ne serait pas générale, et ne concernerait pas tout autant l’histoire ancienne? Ceci, bien que sont développés heureusement quelques faits véridiques. Un moindre mal.
Je vais ci-après inclure mes observations.
LE DICTIONNAIRE « D’HISTOIRE » DE BRETAGNE
Voici ici les observations que je compte faire aux auteurs et éditeurs de ce livre.
HARPE : L’article de Fañch Postic.
Dans un article court, il prend le temps d’émettre de gros doutes sur la présence ancienne de la harpe en Bretagne. Ses arguments sont plutôt légers, contradictoires, voire incohérents.
1/ F. Postic reconnaît l’existence ancienne du mot « Telenn » en Bretagne. C’est bien. Par contre, il affirme que ce mot est répertorié au Moyen-Age, ce que j’aimerais bien, mais qui n’est pas totalement prouvé avant le 17ème siècle. Mais effectivement on peut supposer qu’il est bien plus ancien. Donc, là, il irait dans mon sens.
2/ Mais, dans une même phrase il met en doute la harpe utilisée pour les lais bretons en même temps qu’il parle de la Lyre de Paule. Quel raccourci !
Ici il met en doute la certitude, partagée par tous, que la lyre de Paule n’était pas une harpe.
Par contre, pour les lais bretons, il va dans le sens de ceux qui ont maintes fois utilisé l’argument éculé du nom latin « cithara ». Ni leurs auteurs, ni F. Postic, n’ont pris la peine de faire quelques recherches, ou simplement de lire mon livre «Telenn, la harpe bretonne ». Ils y auraient trouvé des textes médiévaux décrivant, avec précision, en Français, en Anglais, en Occitan, etc., les harpes utilisées en Bretagne, à cordes de boyau ou de métal, sans oublier ses nombreuses représentations. Il faut se demander si cette présence ancienne de la harpe les gêne.
Par ailleurs, on peut quand même remercier F.Postic d’avoir cité mon père et moi-même. Même si le lecteur ne saura pas qui a fait quoi et quand.
On donne bien quelques dates précises, par ailleurs, dans ce livre, heureusement pour un livre d’Histoire…
RENOUVEAU MUSICAL
Sylvie Blottière-Derrien parle de manière floue des années 50-60-70.
On ne voit pas clairement distinguées deux périodes très différentes :
1/ de la fin des années 40 au milieu des années 60 (environs quinze ans), celle où l’élément central est les bagadoù et la BAS ; BAS qui, très vite, va être tout sauf « discrète ». Autours du flux majeur et central des bagadoù, on peut noter la discrète résurgence du kan-ha-diskan et du fest-noz (1954-Loeiz Roparz), celles (moins discrètes) des chorales en Leon, la renaissance de la harpe celtique (mon père et moi-1953-1954), puis les expériences (encore discrètes) de Evit Koroll et Son ha koroll et les débuts de Glenmor.
2/ Le deuxième mouvement musical qui commence en 1966, un mouvement prenant, dès le départ, le parti pris de la communication professionnelle vers le grand public, du métissage (en particulier avec l’influence « anglo-saxonne », mais pas seulement) et de la modernité radicalisée (guitares électriques, etc.).
Le premier mouvement musical a continué bien sûr quand le deuxième mouvement démarre en 1966, moment où j’ai commencé à chanter sous la forme d’un « folk-song celtique » avant de pouvoir l’élargir à un Folk-rock, notamment. Puis le lancement de ce mouvement avec mon contrat international (1967), service de presse, etc.. Et ensuite, c’est bien ce concert à l’Olympia, complété par Bobino 1973, les tournées, etc. qui ont étendu l’engouement breton au grand public de Bretagne, de France et hors frontières.
Madame Blottière me fait l’honneur alors de me citer ; je l’en remercie.
Mais, autant j’ai été « fan » des sœurs Goadec, autant est erronée la phrase les concernant : elles ne sont jamais passées à l’Olympia. Mais par contre, je l’ai lu ici ou là. Elle se serait servie d’écrits non-vérifiés ? Je n’ose pas le croire.
L’année suivante, c’est moi encore qui chantais à guichets fermés pendant trois semaines à Bobino.
Il est bien vrai que le public de mon concert à l’Olympia, le 28 février 1972 (une date qu’on doit reconnaître historique, donc méritant d’être indiquée avec précision), et les sept millions d’auditeurs qui écoutaient Europe 1 ce soir-là, m’ont reçu avec une chaleur telle que (presque) tout le monde a voulu, le lendemain et après, chanter, danser, jouer breton, voire même apprendre la langue.
Il a été facile, plus tard, de faire venir les sœurs Goadec pour une (seule) soirée avec d’autres bretons et à Bobino. Mais, autant je leur ai fait de la publicité, autant cette soirée-là n’a rien révolutionné (dans le grand public, j’entends).
Vous parlez aussi des ouvertures et métissages musicaux. Mais comme beaucoup, on le présente comme une particularité de la scène bretonne des années 2000, oubliant que c’est ma démarche principale depuis mes débuts, il y a 43 ans… (on dort ?).
FEST-NOZ
Par contre, l’histoire contemporaine du Fest-Noz est très bien résumée.
IDENTITE AFFIRMEE
Je remercie l’auteur de me citer.
Par contre, on parle d’artistes au pluriel.
– Hors, si on parle de promotion de la culture bretonne, on devrait, pour la première période, citer Glenmor, pour un milieu relativement restreint.
– Et ensuite moi-même, pour le grand public.
– Et dire, qu’ensuite, d’autres artistes ont pu appuyer cette démarche.
Donc raconter en trois temps une histoire s’étant déroulée ainsi.
Et ceci peut être dit sans ajouter quatre mots de plus. Par contre la rigueur y gagne.
RIGUEUR
C’est donc bien de rigueur que manque ce livre.
On voit bien ce que j’ai constaté mille fois : une certaine ignorance ou dédain chez beaucoup d’universitaires pour des éléments que leur cursus n’a pas favorisé.
Et on en arrive à l’absurdité absolue : les 60 dernières années apparaissent plus floues que la période des rois de Bretagne (qui n’a pas duré plus longtemps je crois).
Mais, justement, quand on est témoin direct de cette dernière période, et qu’on voit à quel point elle est brouillée, quel crédit peut-on donner à ce qu’on dit sur l’an 800 ?
L’impact déterminant du mouvement musical sur la société bretonne (et même à un certain point hors Bretagne) est loin d’être présenté à sa mesure quand tant de témoins peuvent encore le confirmer.